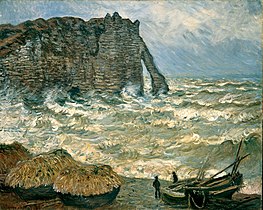Sous la Révolution, l'abbaye doit à sa proximité avec l'Hôtel de Ville
de ne pas être vendue ou détruite. En 1792, le Conseil municipal désigne
l'édifice comme lieu de conservation des tableaux, médailles, bronzes
et autres monuments des arts.
Le 14 Fructidor an IX (1801), le décret Chaptal instituant des
collections de Peintures dans quinze villes de France est l'acte
fondateur du musée de Lyon. L'institution répond aussi à des aspirations
locales, comme rappeler le prestigieux passé romain de la ville et
proposer des modèles à la Fabrique de la soie alors en crise.
A partir de 1803, le Muséum du Louvre envoie 110 tableaux (P.P. Rubens, Le Guerchin, Ph. de Champaigne,).
Pendant tout le XIXe siècle, le bâtiment abrite différentes
institutions. Les musées de peinture, d'épigraphie, d'archéologie et
d'histoire naturelle cohabitent avec la Bourse, la Chambre de commerce, l’École des Beaux-Arts, la bibliothèque de la Ville (section Arts et
Sciences) et des sociétés savantes.
Dès 1803, le public peut découvrir, le mercredi de 10h à 13h, les
premiers tableaux envoyés par l’État. De nouveaux dépôts (G. Reni, Véronèse) et des achats (F. Zurbaran, A. Berjon, )
constituent un véritable musée de peintures qu'inaugure le comte
d'Artois, le 20 septembre 1814. Le Cabinet d'antiques réunit d'anciennes
collections et des acquisitions (Koré grecque). Sous les galeries du cloître, les inscriptions et fragments sculptés romains forment le musée lapidaire.
À partir de 1834, l'architecte R. Dardel (1796-1871) donne une nouvelle
dimension au musée. Dans des espaces restructurés, il réalise un
somptueux décor − uniquement conservé aujourd'hui dans le Médaillier
(ancienne salle des marbres modernes).
Au milieu du siècle, l'éclosion de l'École lyonnaise de peinture et de nouveaux dépôts de l'État (E. Delacroix, J. Pradier, H. Flandrin...) enrichissent notablement les collections.
L'architecte A. Hirsch (1828-1913) engage de grands travaux dans le
bâtiment, le jardin et le cloître. Le plus spectaculaire est la
restructuration de l'aile sud afin de présenter les grands dessins
préparatoires au décor du Panthéon à Paris de P. Chenavard. Le décor de l'escalier monumental est confié en 1881 au Lyonnais P. Puvis de Chavannes .
Dans l'aile est, le musée J. Bernard présente, de 1876 à 1891, les
quelque 300 tableaux que cet ancien maire de la Guillotière a offerts à
la Ville.
Une ambitieuse politique d'acquisitions marque la période. Les
conservateurs achètent lors de grandes ventes et auprès d'antiquaires à
Paris, Rome, Florence, principalement des antiquités,
des œuvres du Moyen-Age et de la Renaissance (groupe sculpté
de L'Annonciation), de l'art islamique et des peintures du XIXe siècle.
Pendant l'entre-deux-guerres, les collections s'ouvrent à l'art extrême-oriental et aux arts
décoratifs modernes. Pendant cette période, plusieurs institutions et
collections quittent le Palais Saint-Pierre : le muséum d'Histoire
naturelle en 1914 et l’École des Beaux-Arts en 1935 ; en 1921, les
œuvres liées à l'histoire de Lyon sont transférées vers le nouveau musée
de Gadagne. L'église désaffectée est dévolue aux sculptures des XIXe et
XXe siècles.
Après-guerre,
des rétrospectives consacrées à des artistes modernes, tels P. Picasso
ou H. Matisse, permettent des acquisitions majeures (M. Larionov). Le fonds s'enrichit aussi de dons.
A la fin des années 1960, le départ des antiquités nationales vers le
nouveau musée de la Civilisation gallo-romaine et le transfert de la
galerie égyptienne du musée Guimet de Lyon bouleversent les collections.
Plus récemment, le musée d'art contemporain quitte le Nouveau
Saint-Pierre (aile construite vers 1860 par l'architecte T. Desjardins).
En 1989, une réflexion sur l'état et les missions du musée aboutit à un
vaste projet de rénovation (ville de Lyon - État dans le cadre de la
Mission des Grands Travaux). Le conservateur Ph. Durey et les
architectes Ph.-Ch. Dubois et J-M. Wilmotte entreprennent une restructuration complète du bâtiment.
Les travaux sont réalisés en cinq tranches, de 1990 à 1998, afin de ne
jamais fermer au public. La surface couvre 14 500 m2 et les collections
occupent 70 salles. Le musée des Beaux-Arts regroupe le Palais
Saint-Pierre, l'église et le Nouveau Saint-Pierre.